Le biais du statu quo : comprendre et apprivoiser notre résistance au changement
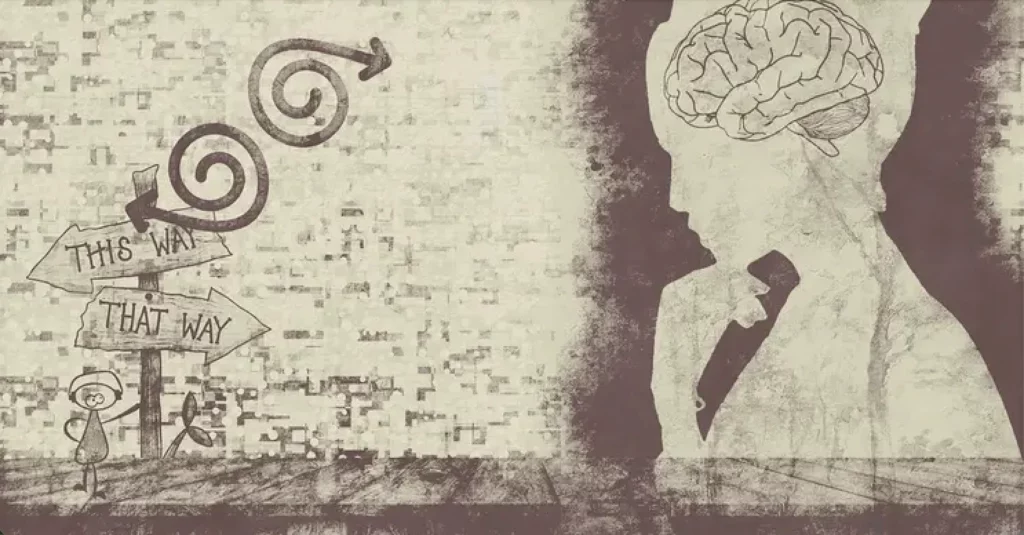
Très souvent, il m’arrive de vouloir changer. Mettre en place de nouvelles choses dans ma vie, ou en supprimer d’autres.
Par exemple, une routine sportive. Aller courir 2 fois par semaine.
Ou bien m’octroyer un week-end en solo, dans une cabane cozy quelque part en forêt. Pour faire un reset, pour me retrouver face à moi-même pour la première fois depuis la naissance de mon fils.
Je ressens fort le besoin de ces deux choses. Je suis pleinement consciente des bénéfices multiples que j’en retirerai, et pourtant, je reste-là. Tiraillée entre envie, et inertie.
À regarder mes chaussures de running dans l’entrée, et à scroller Airbnb sans jamais réserver de cabane.
Alors une question s’impose : Pourquoi est-ce si difficile de changer, même lorsque ce changement nous serait bénéfique ?
Est-ce vraiment une question de temps ? D’argent ?
En réalité, aucune de ces excuses ne justifie cette immobilité.
Ce qui justifie cette immobilité, c’est un biais cognitif bien plus puissant : le biais du statu quo – un mécanisme naturel de notre cerveau qui nous retient dans notre zone de confort.
Le biais du statu quo : pourquoi notre cerveau résiste au changement
a. Un mécanisme de survie avant tout
Le biais du statu quo, c’est une tendance naturelle de notre cerveau à nous maintenir dans une situation connue – plutôt qu’à nous risquer à l’inconnu, peu importe le bénéfice à la sortie.
Le cerveau ne s’intéresse pas réellement à ton épanouissement. Il est bien plus pragmatique.
Il cherche à fonctionner de façon optimale, tout en économisant au maximum son énergie.
Et c’est ici que tout s’explique.
En ayant conscience de ça, maintenant, imagine.
Tu proposes à ton cerveau de rester dans une routine.
Peut-être qu’elle ne t’épanouit pas pleinement… Mais elle fonctionne plus ou moins correctement.
Cette routine, elle est presque automatique. Elle est prévisible. Stable.
Tu es dans ta zone de confort.
Les connexions neuronales associées à cette routine sont en places, connues, utilisées chaque jour.
Ton cerveau adore ça : c’est simple, efficace, prévisible.
Maintenant, tu lui proposes autre chose.
Une nouvelle habitude. Un projet inconnu. Un saut vers quelque chose de plus juste pour toi.
- Tu réponds a une offre de boulot pour un poste dont tu as toujours rêvé.
- Tu décides de te choisir toi, enfin, et de laisser de côté cette relation dans laquelle tu t’effaces.
- Tu veux arrêter de fumer. Supprimer le sucre. Reprendre le sport.
Tous ces choix vont dans ton sens. Ils sont pour ton bien. Tu en es conscient, et tu te le souhaites réellement. Et pourtant… Tu restes là.
Pourquoi ?
Parce que ton cerveau s’affole.
Il va devoir s’adapter. Créer de nouvelles connexions neuronales. Apprendre.
Et il déteste ça.
Ce processus lui demande beaucoup plus d’énergie que de continuer dans la zone du connu.
Le biais du statu-quo, c’est donc ça : un biais cognitif commun à tous.
Ce n’est pas de la paresse, ce n’est pas un manque de courage.
C’est une stratégie de survie de ton cerveau.
Une volonté de te protéger, tout en conservant son énergie et son sentiment de sécurité.
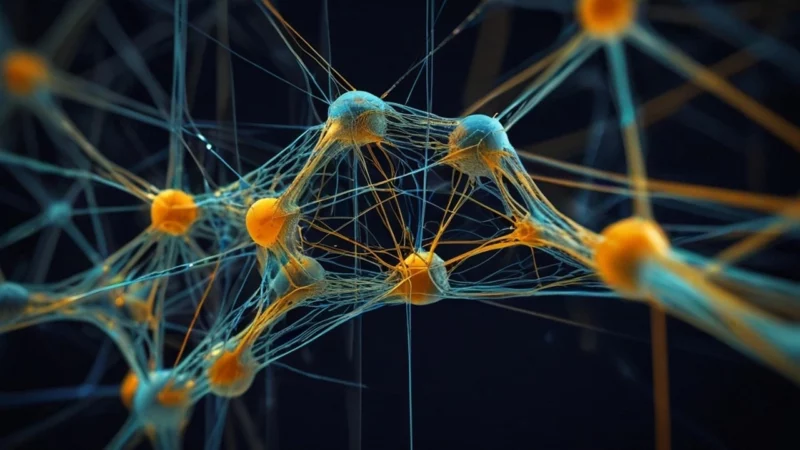
b. Quand le changement réveille la peur
L’immobilisme face à au changement s’explique donc par cette recherche d’économie d’énergie du cerveau.
Mais on peut étayer cette réponse en allant creuser un peu plus du côté des neurosciences.
Comme on l’a dit, le cerveau aime la prévisibilité. Le connu. Sa zone de confort.
Pour lui, le changement, l’inconnu, au delà de lui demander plus d’énergie dans la création de nouvelles voies neuronales, est aussi synonyme d’incertitude. Et donc créateur de stress…
Biologiquement, qu’est-ce que le stress ?
C’est le corps qui réagit face à un danger potentiel. Tu peux en découvrir davantage sur l’origine du stress juste ici, mais globalement, voilà comment ça marche :
Face à un danger potentiel (ici, l’incertitude, l’échec potentiel du changement), l’amygdale secrète un combiné d’hormones : le cortisol, et la noradrénaline. Ces deux hormones préparent le corps au fameux réflexe « fuite ou combat ». Souvent, la fuite gagne, soit : l’immobilisme.
Et le projet de changement est à l’arrêt.
Tu stagnes, figé(e) entre l’envie d’avancer et le besoin de te sentir en sécurité.
c. Quand nos croyances se rebellent
D’un point de vue plus psychologique, le changement vient mettre le cerveau face à une dissonance cognitive.
En effet, toutes nos routines et habitudes reposent sur un ensemble de croyances identitaires :
- Je suis un(e) couche tard
- Je ne suis pas sportif(ve)
- Ce travail, c’est ce que je sais faire de mieux.
Ces croyances forment ta stabilité interne.
Elles sont prévisibles, cohérentes, rassurantes. Elles apportent au cerveau une sécurité.
En proposant au cerveau du changement (se coucher plus tôt, se mettre à la course à pied, changer de travail), on vient remettre en question tout le système de croyances sur lequel il se reposait jusqu’à présent.
Tout ce qui était considéré comme vérité. On bouscule cette stabilité en apportant deux informations contradictoires :
- Je dois me coucher tôt…. Mais je suis un couche-tard ?
- Je dois me mettre à la course à pied… Mais pourtant, je ne suis pas sportif(ve).
- Je dois chercher un nouveau travail… Mais celui que j’ai, c’est ce que je sais faire de mieux !
Ces informations opposées créent un conflit interne, de la confusion.
De la tension. Un tiraillement.
C’est ce qu’on appelle une dissonance cognitive.
Un manque de cohérence entre ses actions et son système de croyances.
Le cerveau cherche donc à réduire cette tension, cette douleur.
Et pour ça, il a deux moyens :
- Accepter ce changement, et réécrire une partie de son système de croyances,
- Revenir au connu, là où tout est stable, fluide, prévisible.
Quelle est la sortie gagnante ?
La plupart du temps : revenir au connu. Parce que c’est moins énergivore, moins stressant, plus rassurant.
Et on se retrouve, encore, immobile face au changement.
Pas par manque de volonté, mais parce que notre cerveau fait exactement ce pour quoi il est conçu : nous protéger.
Alors, comment fait-on pour avancer sur nos projets, pour mettre en place le changement qui nous verra grandi ?
Pour dépasser ce statut quo ?
Comment apprivoiser le biais du statu quo
La bonne nouvelle, c’est que ce biais du statu quo n’a pas à être gagnant. Tu peux le dépasser – avec un peu de méthode, et de bienveillance.
Voici 4 étapes simples et concrètes, pour te mettre en mouvement en douceur.
a. Observer sans juger
La première chose à faire est d’observer.
Lorsque l’envie de changement se dessine, observe tes réactions. Sans te juger.
Repère les moments où le biais du statu quo rentre en jeu. Ou tu restes dans le connu, par « sécurité ». Tu trouves des excuses. Tu procrastines.
Puis pose-toi 3 questions simples :
- Que se passe-t-il dans ton corps ?
- Quelle phrase, en interne, vient justifier ton inaction ?
- Que souhaites-tu vraiment, quel est ton objectif ?
L’idée est de venir apporter de la conscience sur ton immobilité. D’essayer de la comprendre. De transformer la culpabilité, en curiosité.
b. Réduire l’incertitude
L’incertitude fais peur : rend-le plus familier.
Prends le temps de te fondre dans l’étape préliminaire de la conception de ton projet, de ton changement. Lis, documente-toi, visualise les étapes qui t’attendent, essaie.
Tu ne t’engages pas dans le changement définitivement ici. Tu viens toucher un peu plus du doigt ton sujet. Pour moins le craindre.
Tu viens le rendre plus concret, plus atteignable. Moins menaçant.
c. Avancer par micro-changements
C’est la partie : petits pas, mais pas réels.
Tu rentres dans l’action. Découpe ton objectif de changement en mini-objectifs.
Que peux-tu faire, aujourd’hui, d’atteignable, de non-intimidant, qui te rapproche de ton objectif ?
- Postuler à une annonce ciblée par semaine,
- Méditer 1 minute de plus par semaine,
- Aller courir 10 minutes pour voir comment tu te sens ?
Prends le temps, étape par étape. Je t’invite à lire l’article concernant la méthode des petits pas pour découvrir cette méthode en profondeur.
Cette méthode est ta porte d’entrée vers le changement que tu te souhaites.
d. Récompenser le progrès
En cours de route, n’oublie pas de reconnaitre tes avancées. D’en être conscient.
Mais aussi de les récompenser, aussi minimes soient-elles.
Ton cerveau apprends par associations. En associant le changement au plaisir, à la gratification, la résistance décroîtra.
Et il sera plus facile, peu à peu, d’embrasser le mouvement.
Accepter la vulnérabilité du changement
Comme je l’évoque dans l’article sur la méthode des petits pas, le changement nous place dans une position de vulnérabilité.
Pourquoi ? Parce que au moment où tu choisis de changer, tu redeviens débutant.
Tu sors du connu, et rien n’est encore gagné.
Tu entres dans une zone mouvante, faite d’essais, d’erreurs, d’ajustements.
Et c’est précisément cette phase de transition qui est inconfortable.
Faire face à l’incertitude, à tes maladresses, à la lenteur du progrès… tout cela vient bousculer ton besoin de maîtrise. Pourtant, c’est le passage obligé de tout apprentissage durable.
Changer, c’est accepter cette part de déséquilibre. D’inconfort. De transition.
Alors, je t’invite à regarder cette vulnérabilité non pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de présence.
Tu es là, à chaque étape du processus, pleinement.
Tu expérimentes, tu ajustes, tu apprends.
Et c’est justement ça, la force :
Rester ouvert(e), curieux(se), vivant(e) dans le mouvement du changement.

Maintenant, tu constates que l’inaction face à une volonté de changement a non seulement un nom, ce fameux biais du statu quo, mais aussi plusieurs explications derrière elle.
Des explications neuropsychologiques. Tangibles. Plus vastes que la paresse ou le manque de volonté.
Mais tu repars aussi avec des clés concrètes. Pour comprendre ce mécanisme, l’apprivoiser, et te remettre en mouvement.
Alors je t’invite simplement à faire face à ton objectif, avec un oeil neuf, bienveillant envers toi-même. Et à faire le premier pas vers toi.
Et tu n’as pas à faire ce pas seul(e). Si tu ressens le besoin d’être accompagné(e) sur la voie du changement, d’être guidé(e) dans la transition que tu rencontres, n’hésite pas à me contacter.
Je serai heureuse de faire ce chemin avec toi.




